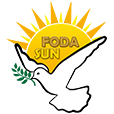Stratégies de développement des relations culturelles entre l’Iran et la France

Stratégies de développement des relations culturelles entre l’Iran et la France[1]
L’étude des relations internationales révèle qu’avant même les dimensions diplomatiques et juridiques entre les États, ce sont les échanges culturels entre les peuples qui constituent le fondement véritable des relations internationales. Les premières racines des interactions culturelles entre l’Iran et la France remontent aux XVIe et XVIIe siècles, notamment avec la rédaction des récits de voyage par les explorateurs français en Iran. L’examen de cette histoire riche et ancienne montre que, au-delà des relations diplomatiques officielles, les peuples iranien et français ont tissé des liens profonds et durables (Mohammadzadeh, 2021, p. 190). La diversité des productions littéraires dans les deux pays, telles que les récits de voyage, les vocabulaires et expressions communs, les similitudes architecturales, ainsi que l’intérêt soutenu des institutions culturelles comme la Société Asiatique de Paris pour l’iranologie, en sont autant de preuves manifestes (Hamidi, 2021, p. 141).
De nos jours encore, afin de renforcer ces relations profondes et historiques, il est essentiel que les gouvernements s’appuient sur l’étude des modèles culturels existants et adoptent des stratégies favorisant l’enrichissement des échanges interculturels. Une telle approche conduira inévitablement à la consolidation de la diplomatie culturelle et, par conséquent, au renforcement des liens diplomatiques (Kavousi, 2012, p. 5).[2]
Dans cette proposition, émanant de la partie iranienne, nous proposons des stratégies concrètes et concises visant à approfondir les divers aspects de cet échange culturel entre l’Iran et la France.
- Promotion et diffusion de la musique traditionnelle iranienne auprès de la société française :
- Organisation de concerts de musique classique iranienne avec la participation d’instrumentistes et de chanteurs des deux pays. Par exemple, des concerts mettant en avant la richesse de la musique classique iranienne, en combinant instruments traditionnels persans et instruments occidentaux.
- Organisation de représentations musicales traditionnelles iraniennes en France.
- Mise en place d’expositions en France pour faire connaître et promouvoir les instruments de musique iraniens, ainsi que l’enseignement de leur pratique à la société française. Ces instruments incluent les percussions et cordes telles que le setâr, le târ, l’oud, le santour, le daf, le dohol, le daïreh, le tombak, le naqareh, et d’autres instruments traditionnels régionaux comme le ney-ânbân, le tanbur, etc.
- Création de plateformes de visibilité pour les artistes iraniens en partenariat avec des festivals musicaux renommés en France, tels que le festival « Les Chaises Dieu » ou le festival « Aix-en-Provence », afin de promouvoir la musique iranienne.
- Introduction de l’architecture iranienne en France
- Utilisation du virtuel et de la réalité augmentéepour promouvoir les musées, quartiers et monuments des villes des deux pays.
- Organisation de circuits thématiquespour les étudiants des deux pays, afin de renforcer leur immersion culturelle réciproque.
- Soutien à l’organisation de voyages familiauxaxés sur la découverte des villes et villages méconnus des deux pays.
- Présentation d’expositions dans des lieux emblématiques comme le Centre Pompidou à Paris ou le Musée des Beaux-Arts de Lyon, mettant en lumière les styles architecturaux iraniens à travers des structures symboliques telles que les majestueuses mosquées d’Ispahan ou les jardins persans.
- Sensibilisation et éducationà l’architecture via des supports adaptés aux enfants (animations, films, livres, livrets pédagogiques) et des événements ludiques.
- Ateliers d’architecture(courts et moyens termes) pour étudiants sélectionnés, incluant des écoles d’été ou des camps de recherche.
- Promotion de programmes d’études et de boursespour les diplômés et enseignants en architecture, urbanisme et restauration patrimoniale.
- Formations spécialiséessur les systèmes constructifs, les méthodes de gestion urbaine et les innovations, dispensées périodiquement via le numérique et le métavers.
- Projets collaboratifsentre éminents architectes, urbanistes et restaurateurs des deux pays, intégrant de manière créative des éléments typiquement iraniens (iwans, dômes, mosaïques) dans l’architecture contemporaine française. Une approche basée sur les « zones de confluence architecturale » sera privilégiée pour analyser les influences socio-politiques sur l’esthétique persane.
- Coopérations dans le domaine de l’éducation
- A. Coopérations interuniversitaires
- Programme de facilitation des échanges étudiantsentre la France et l’Iran.
- Collaboration entre enseignants-chercheursdes universités d’excellence des deux pays, centrée sur des disciplines communes en vue de publications conjointes (ouvrages, articles). Les domaines prioritaires incluent :
- Les différentes branches du droit, compte tenu des similitudes entre les systèmes juridiques d’inspiration romano-germanique des deux pays.
- Le droit international, les relations internationaleset les études globales, pour le partage d’idées et le renforcement des liens diplomatiques.
- Les sciences sociales, l’anthropologie, la sociologie, la philosophieet l’histoire, afin de favoriser le dialogue interculturel.
- Création de maisons d’édition spécialiséespour diffuser les travaux collaboratifs.
B. Coopération entre instituts linguistiques
- A. Coopérations interuniversitaires
- Partenariats entre instituts iraniens et françaisd’enseignement des langues.
- Invitation de touristes et expatriés françaisà intervenir comme enseignants de langue.
C.Coopération entre institutions scolaires (public cible : élèves des deux pays)
- Collaboration entre le Bureau d’élaboration des programmes scolaires iranienset les enseignants/institutions françaises pour :
- Concevoir des programmes pédagogiques efficaces.
- Partager des méthodologies d’élaboration de manuels scolaires.
- Échange de méthodes d’enseignement innovantes(sciences expérimentales, mathématiques, sciences humaines) impliquant des enseignants renommés des deux pays.
- Intégration du numérique éducatif: classes virtuelles, échanges culturels en ligne.
- Collaboration entre le Bureau d’élaboration des programmes scolaires iranienset les enseignants/institutions françaises pour :
D. Autres initiatives
- Festivals littérairesautour de :
- La poésie persane.
- La lecture de récits de voyage, pour explorer les influences historiques croisées (ex. : impact de la Révolution française en Iran, courants intellectuels iraniens).
- Ateliers et débatsassociant étudiants iraniens et français, avec la participation d’étudiants en français, littérature, philosophie, droit et histoire (maîtrisant le français/persan) comme médiateurs.
- Organisation d’événements en lignepour une accessibilité élargie.
- Festivals littérairesautour de :
- Échanges culinaires et gastronomiques
- Festivals de cuisine traditionnelle iranienne en France:
- Présentation de plats authentiques iraniens, desserts, pains traditionnels et spécialités régionales.
- Dégustations et ateliers interactifs pour le public français.
- Plateformes en ligne de partage de recettes:
- Diffusion de techniques culinaires iraniennes via des tutoriels vidéo et des blogs collaboratifs.
- Collaborations entre chefs des deux pays:
- Création de fusion gastronomiques (mariage des saveurs persanes et françaises).
- Organisation de concours culinaires binationaux.
- Festivals de fruits secs et de noix:
- Mise en avant des noix, amandes et épices iraniens dans des événements innovants.
- Promotion des méthodes de préparation traditionnelles.
- Stratégies pour l’artisanat
- Festivals de mode mettant en valeur le textile iranien:
- Expositions de châles, manteaux et étoffes iraniennes (le termeh, broderies).
- Partenariats entre designers iraniens et français:
- Création de collections hybrides (alliant motifs persans et esthétique contemporaine).
- Expositions de tapis et tissus iraniens:
- Tapis villageois, nomades (Bakhtiari), pièces vintage et chefs-d’œuvre des villes (Ispahan, Tabriz).
- Salons d’artisanat iranien en France:
- Céramiques, mosaïques, marqueteries, émaux.
- Solutions pour les arts du spectacle et le cinéma
- Théâtre historique et local iranien:
- Représentations de formes traditionnelles comme le « Ta’zieh ».
- Coproductions théâtrales:
- Ateliers et festivals communs pour échanges artistiques (Yari Astehbanati, 2022, p. 268).
- Accords entre plateformes de streaming:
- Distribution de films iraniens sous-titrés/doublés en français.
- Adaptation d’œuvres littéraires et historiques.
Conclusion
Les relations culturelles ancestrales entre l’Iran et la France se reflètent dans leurs œuvres littéraires et architecturales, tandis que leurs influences mutuelles ont marqué des moments-clés de leur histoire intellectuelle – de la Révolution française aux mouvements de pensée modernes en Iran. Malgré les défis politiques actuels, les deux États peuvent renforcer et enrichir leurs liens culturels en mettant en œuvre les stratégies proposées dans ce document.
Les études historico-culturelles démontrent que la promotion d’une coopération autour du patrimoine partagé ne rapproche pas seulement les peuples et n’enrichit pas uniquement leurs cultures respectives : elle ouvre aussi la voie à un approfondissement des relations diplomatiques. Par ailleurs, l’application des solutions évoquées facilitera la protection des droits des migrants et l’adoption d’un modèle d’intégration culturelle harmonieux dans les deux pays.
Références
- Hamidi, S. (2021). L’iranologie en France : étude des recherches sur l’Iran menées par la Société asiatique de Paris (1822-1922). Revue scientifique-culturelle des langues et civilisations anciennes, 2(2), 125-146. (En persan)
- Mohammadzadeh, A. (2021). La place des récits de voyage français dans la préservation des relations culturelles irano-françaises au XVIIIe siècle. Journal de recherche en langue et traduction françaises, 4(1), 188-208. (En persan)
- Kavusi, A. (2012). Conception d’un modèle de développement des relations interculturelles à l’ère de la mondialisation. Revue du management culturel, 6(17), 1-16. (En persan)
- Yari Astehbanati, M. (2022). Analyse des variables influençant la diplomatie artistique française envers l’Iran au XXe siècle : une réflexion basée sur la théorie de James N. Rosenau. Revue semestrielle des affaires étrangères iraniennes, 13(1), 263-288. (En anglais)
[1] Saba Golnarkar, Candidate au doctorat en droit international, Faculté de droit, Université de Téhéran, saba.gol@ut.ac.ir
[2] Voir également: Sarı, İ. (2023). Rivalité franco-iranienne au Moyen-Orient : stratégies, interactions et conséquences. The Journal of Iranian Studies, 7 (1), 53-81. (En anglais)